Claude Henri De Saint Simon
Introduction
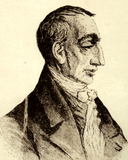
Pour mieux comprendre l’homme voici quelques extraits du livre : « Nouvelle histoire des idées politiques », éditions Pluriel par Pierre Ansart et du livre « Saint Simon et le saint simonisme », éditions puf par Pierre Musso.
Dans les années 1820, alors que l’Europe vient de connaître trente années de bouleversements politiques, Claude de Saint Simon acquiert la certitude qu’il assiste non seulement à l’effondrement d’un ordre révolu, mais aussi à l’avènement d’un nouveau type de société qu’il qualifie de « système industriel ». De 1820 à 1825, il se consacre à l’analyse et à la défense de ce nouveau système et à la recherche des moyens pour le faire advenir.
Une conception de la société
L’histoire des sociétés européennes depuis le Haut Moyen Age est essentiellement marquée, affirme-t-il, par la succession de trois « modes d’organisation sociale » ; la connaissance de cette succession permet de comprendre la nécessité historique de l’instauration de la société industrielle.
Le système féodal, à travers ses multiples péripéties, constitue une organisation sociale possédant sa logique propre. Fondé sur la « combinaison » de deux pouvoirs : le pouvoir religieux et le pouvoir militaire, il assurait les conditions d’un équilibre. Une telle société, organisée en vue de la guerre et de la défense, met à sa tête les chefs les mieux préparés à réaliser cet objectif : les chefs militaires. Elle réserve aux autorités religieuses le pouvoir spirituel appelant à l’obéissance dans un système hiérarchique et de domination. Dans un tel système, que Saint Simon qualifie aussi de « gouvernemental », les relations politiques sont déterminantes et assurent la soumission des producteurs aux nobles et aux religieux.
Saint Simon analyse la décomposition de ce système en termes de progression des « facultés productives » venant détruire l’équilibre ancien. Ce développement des facultés productives, assurant l’enrichissement et l’affirmation intellectuelle du Tiers Etat, dresse progressivement la « classe des industriels » contre le pouvoir féodal, et les sciences contre la religion. C’est ce qu’exprima sans pouvoir y répondre adéquatement, la Révolution de 1789.
Saint Simon considère donc les années 1820 comme une phase de transition, une période d’achèvement de la décomposition historique du système féodal, et qui prépare le nécessaire avènement du nouveau système : la société industrielle.
Les grandes lignes de cette société peuvent être décelées car elles ne feront que confirmer le processus déjà en cours dont l’essentiel est l’extension de « l’industrie » avec toute ses conséquences sociales et politiques. Comme l’écrit Saint Simon dès 1817 : « La société tout entière repose sur l’industrie », entendant par ce terme, non pas le seul secteur manufacturier, mais bien toutes les formes de la production et de la circulation : l’agriculture, les artisanats, les fabriques et le commerce. Il n’en sépare pas les connaissances scientifiques et les arts qui, selon leurs propres modalités, participent à la production.
De même que le système féodal avait pour but collectif la guerre et la défense militaire, le système industriel aurait pour but exclusif la production des biens matériels et intellectuels, la domination de la nature, la satisfaction des besoins. Ce système recèlerait une dynamique fondamentale imposant la primauté de la « classe des industriels », l’instauration de rapports de « sociétaires » et non plus de domination.
Dans sa célèbre Parabole des abeilles et des frelons, Saint Simon oppose radicalement les classes politiquement dominantes et parasitaires, vestige à ses yeux de l’oppression féodale, et la classe des industriels. Une société industrielle signifierait l’élimination des classes parasitaires et l’avènement des producteurs dans leur ensemble, c'est-à-dire de tous ceux qui participent à la production et à la circulation des richesses. Cette inversion des rapports de classe n’entraînerait pas l’apparition d’une nouvelle domination puisque l’industrie impose à tous des rapports d’association. Aussi fortement que le système féodal imposait des relations de hiérarchie et d’obéissance pour réaliser ses objectifs guerriers, la société industrielle impose des relations d’association dans l’action commune de production.
Et de même que, dans le système féodal, les décisions concernant les actions communes étaient prises par les militaires et les chefs politiques, dans la société industrielle, les décisions concernant le travail commun seraient prises par les producteurs, dans l’intérêt de tous, et seraient donc approuvées par la collectivité. Tandis qu’une société de domination impose des décisions contre la volonté des producteurs, une société industrielle prendrait ses décisions à leur demande, avec leur appui, et les exécuterait selon des plans rationnels. Echappant au désordre de la domination, la société industrielle serait une société « organisée ». Pour la première fois dans l’histoire, la société devient humaine : elle se propose ses propres buts en accord avec les exigences des hommes qui la composent. La société devient « positive » en ce sens qu’elle agit pleinement et par elle-même, en se faisant, pour la première fois, le sujet et l’objet de son action.
Saint Simon ne doute pas que ce nouveau modèle de société, correspondant à l’évolution générale des sociétés modernes, ne soit appelé à devenir le modèle de toutes les sociétés européennes. Dès 1814, en collaboration avec Augustin Thierry, il appelait à une réorganisation pacifique des nations européennes et à l’union de l’Europe dans une « société européenne ». Il pensait aussi que l’Europe serait appelée à diffuser ce modèle de société à travers le monde entier.
A la question de savoir comment cette société industrielle pourrait supplanter l’ordre ancien, Saint Simon esquisse plusieurs réponses complémentaires. Sa réponse la plus générale se fonde sur le caractère inéluctable du développement industriel : l’extension des « facultés productives » comme le progrès des connaissances scientifiques donneront nécessairement une force croissante aux producteurs contre les classes déclinantes. Mais il ajoute aussi qu’une action résolue, et historiquement justifiée, de la classe des industriels, accélérerait ce processus en écartant les obstacles politiques. Dans cette voie, ses écrits prennent parfois les accents d’un appel à une lutte des classes dans laquelle l’ensemble des producteurs, agriculteurs, « chefs de travaux industriels», savants et ouvriers sont incités à lutter contre les classes parasitaires.
Le dernier ouvrage, Le Nouveau Christianisme, infléchit ces appels en un sens moral. Comme s’il redoutait que cette société industrielle ne réalise pas spontanément cette « association » espérée, Saint Simon réaffirme que cette société industrielle devra se donner pour objectif primordial d’« améliorer le plus rapidement l’existence de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre ». Pour parvenir à ce but, une nouvelle religion civile serait nécessaire qui, reprenant l’inspiration primitive du christianisme, permettrait la réorientation des énergies et l’avènement de la société industrielle. Plus nettement que dans ses écrits antérieurs, Saint Simon fait appel à l’action des industriels, inspirée par une théorie et une morale nouvelles pour édifier cette société industrielle et il s’en fait, plus fortement encore, le prophète.
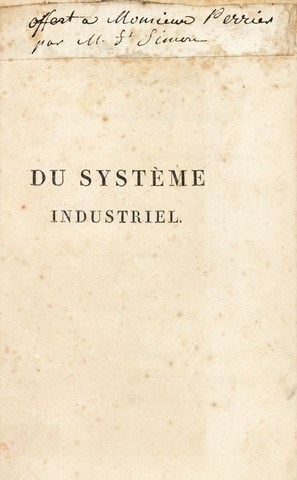
Une nouvelle théorie politique
Cette conception de la société industrielle comporte une critique du politique et appelle à une nouvelle théorie politique. Dans son interprétation du passé comme dans sa critique de la Restauration, Saint Simon tend à assimiler le pouvoir politique aux pouvoirs de domination. Il qualifie le système féodal de régime « gouvernemental » pour souligner qu’à ses yeux, l’ordre établi se maintenait grâce à l’exercice contraignant d’un pouvoir sur les volontés. Et de même accuse-t-il violemment les « légistes » de la Révolution de 1789 d’avoir cherché à reconstituer de nouveaux pouvoirs politiques au lieu de libérer les industriels des oppressions politiques.
Dans cette société industrielle, société sans précédent historique, le politique changerait radicalement de sens et de contenu. L’exercice traditionnel de pouvoir autoritaire disparaîtrait et se trouverait remplacé par une activité sociale totalement opposée : la production, « l’administration des choses ». L’organisation des travaux collectifs se substituerait à l’exercice des contraintes sur les hommes. L’administration des choses, la production et la création collectives remplacerait définitivement le politique au sens du pouvoir exercé sur les volontés.
Saint Simon invite ainsi à créer ce qu’il nomme une « science de l’homme » ou « science des sociétés » à laquelle il assigne une double tâche. En premier lieu, cette science de l’homme aurait pour objet de repenser positivement l’histoire et Saint Simon esquisse ici le principe selon lequel la science politique ne saurait être qu’histoire. Il cite avec éloge l’ouvrage de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique de l’esprit humain qui eut le mérite de surmonter la dispersion des histoires traditionnelles et d’avoir dressé un tableau synthétique de l’évolution des civilisations. Mais il reproche à Condorcet d’avoir abandonné l’esprit d’observation au profit des préoccupations apologétiques et d’une philosophie du progrès. A ce tableau d’inspiration philosophique, il convient de substituer une science des systèmes sociaux dans leurs particularités et leurs différences.
En second lieu, cette science de l’homme aurait pour tâche d’analyser les lignes de force de l’évolution présente : l’extension de l’industrie, la régression des structures politiques anciennes, la nécessaire progression de la classe des producteurs… Cette connaissance de l’évolution constituerait une véritable force sociale en ce qu’elle permettrait aux producteurs de prendre conscience de leur véritable rôle historique et ainsi les entraînerait à s’opposer aux classes parasitaires. La science de l’histoire permettrait à la classe des industriels de prendre conscience d’elle-même.
Dans la société industrielle, la science des sociétés aurait un rôle tout à fait nouveau : elle n’aurait plus à ce limiter à la critique de l’ordre existant, elle participerait au fonctionnement de la société industrielle en donnant à tous les « idées communes » nécessaires à l’association des énergies. Elle rappellerait les buts communs de la production, elle constituerait une philosophie pratique apte à donner aux hommes une claire conscience de leur action. Une telle théorie pratique ne distinguerait plus le politique social et de l’économique, elle ferait disparaître ces clivages propres aux sociétés anciennes.
On peut comprendre qu’une telle théorie unissant dans une vision prophétique tant de thèmes provocants ait soulevée l’enthousiasme et les indignations. La dénonciation de la classe dominante, l’appel à la révolution des industriels, l’annonce de « l’association industrielle » future répondait à de multiples attentes sociales dans les jeunes générations des années 1825-1830 et dans les classes populaires.
Les saint-simoniens
Au lendemain de la mort de Saint Simon, ses proches amis décidèrent de reprendre le projet qu’il avait lui-même formulé : la création d’une publication destinée à faire connaître la nouvelle théorie. Autour de cette revue Le Producteur, puis autour du journal Le Globe, se groupèrent ceux qui allaient devenir les fondateurs de l’école saint-simonienne, Enfantin, et Bazard, un groupe d’économistes et de savants parmi lesquels Auguste Comte, Adolphe Blanqui, Philippe Buchez, Michel Chevalier… En 1829 était fondée l’Eglise saint-simonienne qui, à travers de multiples avatars, devait diffuser les thèses de Saint Simon en France et hors de France jusqu’en 1870. Dès les années 1830, les théories de Saint Simon étaient connues et commentées en Allemagne, dans les pays méditerranéens et en Amérique du Sud.
Dans ce foisonnement intellectuel, deux tendances peuvent distinguées : l’une que l’on pourrait qualifier de « néo-capitalisme », l’autre de « socialiste ».
Sous Napoléon III, de grands entrepreneurs et banquiers tel les frères Pereire considéraient que leur action s’inscrivait dans le droit fil de la pensée de Saint Simon : ils en reprenaient l’esprit industrialiste, l’urgence d’accélérer le développement économique, la critique du libéralisme individualiste, l’importance des « capacités », dans une interprétation résolument réformiste des écrits de Saint Simon.
La tradition socialiste tient, au contraire, Saint Simon pour le fondateur du socialisme et son premier théoricien. Proudhon pouvait, en effet, penser que Saint Simon, en affirmant la primauté des producteurs sur la politique, préfigurait les grandes lignes d’un socialisme libertaire. Marx, qui affirmait avoir été « imprégné » des idées saint-simoniennes dans sa jeunesse, pouvait penser qu’en affirmant la primauté de l’économique, le rôle créateur du travail, l’urgence d’une révolution sociale, l’avènement d’une société nouvelle marquée par l’association des producteurs, Saint Simon avait tracé les lignes essentielles de la pensée socialiste.
Une interprétation communément admise aujourd’hui fait de Saint Simon, à l’aube de l’expansion industrielle du XIXième siècle, le théoricien d’une technocratie industrielle, soucieuse d’une rationalisation de l’économie et d’une nouvelle intégration sociale autour des objectifs du développement économique.
Il conviendrait sans doute de nuancer cette interprétation en soulignant l’originalité de sa conception de la planification. Il insiste, en effet, sur l’importance d’un « plan » industriel susceptible d’être accepté par tous. Mais il n’envisage aucunement que ce plan puisse être décidé par quelques « managers » ou technocrates spécialisés. Dans L’Organisateur, il rêve d’une direction composée de trois chambres distinctes : chambres d’invention, d’examen et d’exécution. La première serait un lieu d’imagination où des ingénieurs et artistes seraient chargés d’inventer les projets des travaux à entreprendre pour le développement matériel et culturel de la communauté. La seconde chambre serait chargée de retenir les projets réalisables, mais la première aurait la tâche essentielle d’inventer, d’imaginer l’avenir, et de solliciter les projets et les rêves de tous. Cette utopie indique bien le sens de la vision saint-simonienne dans laquelle le développement industriel serait approprié pour tous dans une association capable d’inventer les conditions de l’épanouissement de chacun.
Repères chronologique
Repères chronologiques d’après le chapitre 1 de « Saint-Simon et le saint simonisme » de Pierre Musso
14 octobre 1760 : Naissance à Paris.
De 1760 à 1777 : Saint Simon passe une enfance turbulente à Falvy où il se passionne à l’hydraulique.
1777 : Départ à l’armée comme sous-lieutenant.
1779 : Départ pour les Amériques avec l’armée de La Fayette.
1781 : Il participe au siège d’York au commande d’une tranchée muni de pièces de mortier.
1782 : Il est fait prisonnier à la bataille navale des îles Saintes.
1783 : Il propose un projet de canal au roi du Mexique.
De 1783 à 1789 : Il alterne projet hydraulique et les études à l’école de Mézières.
De 1789 à 1793 : Saint Simon est de retour en Picardie où il vit à Falvy et Péronne.
Le 7 février 1780 il déclare au conseil de Falvy : « Il n’y a plus de Seigneurs : nous sommes ici tous parfaitement égaux ; et pour éviter que le titre de Comte de vous induise en l’erreur de croire que j’ai des droits supérieurs aux vôtres, je vous déclare que je renonce à jamais à ce titre de Comte que je regarde comme très inférieur à celui de Citoyen »
Cité par M. Leroy dans « la vie de Saint Simon »
Le 20 septembre 1790 il renonce définitivement à son titre devant le conseil de la commune de Péronne et choisi le nom de Claude Henri Bonhomme.
De 1790 à 1797 : Il s’enrichi grâce à des spéculations financières.
Le 4 août 1797 : Il renonce à tous ses biens acquis pendant la révolution.
1798 : Rencontre décisive avec Mr Burdin qui lui fait connaître l’importance de la physiologie.
De 1798 à 1801 : Reprend les études.
1802 : Il s’installe à Genève où il écrit son premier ouvrage : « Les lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains » (publié en 1803).
1807-1808 : Il rédige « L’introduction aux travaux scientifiques du XIXe siècle ».
1810 : De retour à Paris il écrit : « Mémoire sur la science de l’homme ».
1814 : Il publie avec Augustin Thierry « De la réorganisation de la société Européenne ».
De 1816 à 1818 : Il dirige la publication des « cahiers de l’industrie ».
1818-1819 : Il écrit « L’organisateur ».
1819 : Il écrit « parabole ».
De 1819 à 1820 : Publication de brochures formant « l’ouvrage du système industriel ».
De 1823 à 1824 : Rédaction du « Catéchisme des industriels ».
1825 : Rédaction du « Nouveau christianisme ».
Meurt le 19 mai 1825. Haut de page

